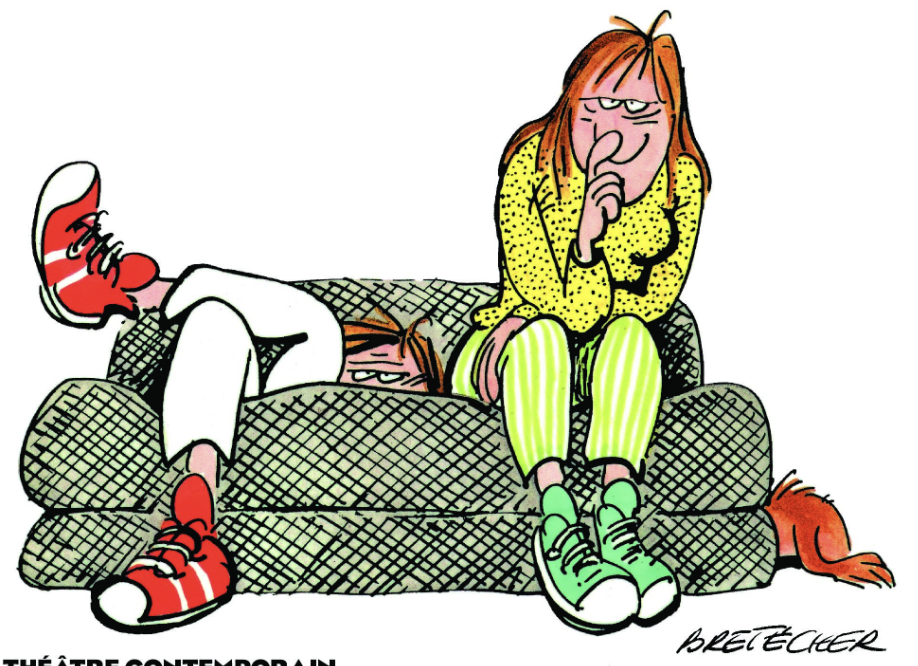Nous avons rencontré le metteur en scène pour évoquer son dernier spectacle Okina joué par l’actrice japonaise Yuri Itabashi (en photo ci-dessus) et inspiré par un Nô à dimension sacrée traditionnellement interdit aux actrices.
Racontez-nous votre parcours au théâtre en quelques mots…
J’ai commencé par une formation universitaire en Arts du Spectacles à Strasbourg, immédiatement suivie d’une formation de scénographe à l’école du Théâtre National de Strasbourg pendant trois ans. J’imagine que c’est l’idée même de « fabriquer » des spectacles qui m’a amené un peu grossièrement à m’intéresser à la scénographie. Cependant, j’ai été assez vite traumatisé par le gâchis matériel que cela impliquait, et j’ai réalisé que j’allais devoir faire autre chose. J’ai rapidement décidé pour moi-même que je ne voulais produire aucun objet nouveau pour la scène, ce qui a rendu mon activité professionnelle comme scénographe un peu compliquée ! Ceci dit, je crois que tous les spectacles que j’ai faits depuis 2015 s’adressent à mon impossibilité d’agir en scénographe : ils essaient de regarder le dispositif théâtral dans ses lignes les plus rudimentaires et interrogent son existence même.
D’où vient le choix du chiffre MDCCCLXXI (1871) comme nom de votre compagnie ?
C’est simplement la date de l’année où il y a eu une Commune à Paris ! Histoire de ne pas oublier que l’art court après cette puissance oppositionnelle…

Vous avez travaillé avec l’acteur japonais Yoshi Oida, puis créé Okina inspiré par un Nô. Comment en êtes-vous arrivés à vous intéresser aux traditions théâtrales japonaises ?
Il n’y a pas de lien direct entre mon travail avec Yoshi Oida et Okina. Et il n’y a pas une fascination particulière pour le Japon qui m’ait conduite à élaborer ces deux projets. C’est par mes recherches sur le rôle et la fonction des interprètes (dont le spectacle Théories et pratiques du jeu d’acteur·rice (1428-2021) a été en quelque sorte un premier compte-rendu) que j’ai été amené à m’intéresser à certaines pratiques théâtrales non-occidentales (comme la danse des Orixas, le théâtre balinais, l’opéra chinois, la danse des lutteurs au Mali, etc.). À la lecture de Zeami, acteur et théoricien japonais du XVe siècle, je me suis intéressé aux formes théâtrales traditionnelles japonaises comme le Nô mais aussi plus vernaculaires comme le Kagura et le Dengaku.
Ces trois pratiques m’ont particulièrement intéressées, car la représentation et l’acteur y occupent une fonction précise au sein d’une grammaire autonome, qu’on ne retrouve plus vraiment dans le théâtre moderne (psychotechnique) de l’ère scientifique. À travers l’idée que le théâtre est un langage en soi, on y impose la croyance en sa capacité unique à symboliser le monde.
Une résidence de plusieurs mois à la Saison Foundation à Tokyo m’a donné l’occasion de rencontrer des acteurs de différentes écoles de Nô à Tokyo, mais aussi de voyager pour voir des spectacles et rituels ultra-locaux, plutôt isolés et très peu référencés. C’était un peu comme une occasion de naviguer dans un univers théâtral de l’ère pré-internet ! C’était pendant le début de l’année 2020, à la période de Setsubun qui célèbre l’année et les cultures à venir et est très riche en rituels traditionnels. J’ai étudié ces pratiques locales, populaires, souvent amatrices, qui ont une façon très spécifique de s’adresser aux gens et de mettre en relation une communauté avec des récits souvent issus de la mythologie ou d’éléments théâtraux agraires et très anciens. La représentation y est souvent inscrite dans la terre où elle se joue et sa fonction est proprement agricole (répondant à divers cycles de croyances et/ou superstitions liées à la bonne conduite des cultures à venir). Cette expérience a bouleversé ma grille de lecture quant aux façons possibles d’organiser un spectacle, et de mener une représentation.
Comment vous est venue l’idée d’Okina ?
C’est à Tokyo que j’ai vu pour la première fois une actrice de Nô sur scène, dans une pièce intitulée Hagoromo. En contactant son école, j’ai pu la rencontrer et la sonder sur son point de vue de femme dans ce milieu très hiérarchisé et patriarcal, où tous les grands maîtres sont des hommes. Elle m’a par exemple expliqué que 20% des acteurs de Nô sont des actrices, mais que 80% des actrices mènent exclusivement des ateliers de transmission, d’où leur très faible visibilité. Elle m’a également expliqué que tous les rôles du Nô étaient ouverts aux femmes, sauf un : celui d’Okina.
J’ai alors fait un lien entre cette interdiction et la démarche que j’avais eu pour ma pièce La naissance de la tragédie, où un acteur imaginait comment pouvait avoir lieu la première représentation des Perses d’Eschyle. Plutôt que rechercher à mimer cette représentation perdue, l’acteur nous la rendait disponible par son seul récit imaginaire.
J’y ai vu un écho, la possibilité pour une actrice de raconter cet Okina qui lui est refusé, sans rien y incorporer de la pièce d’origine, et ainsi de se l’approprier.
Ces deux pièces se répondent donc en quelque sorte : on tente par l’imagination de rendre à soi-même quelque chose qui ne nous est pas disponible, soit parce que cela a disparu, soit parce que cela est proscrit.
De retour en France, j’ai mené des échanges avec l’actrice de Nô autour de cette idée, espérant aboutir à une prochaine pièce. Mais un jour j’ai reçu un mail de son maître m’indiquant qu’elle interrompait le travail, car elle pensait arrêter sa carrière. C’était une grande déception, mais j’y ai aussi vu l’expression des difficultés et de la pression rencontrées par les actrices dans ce milieu. Ce qui amenait de l’eau à mon moulin… J’ai ensuite tenté de rencontrer d’autres actrices de Nô voulant travailler sur le projet, mais sans succès. A chaque fois on me répondait que c’était impossible et qu’aucune actrice ne saurait me parler d’Okina. J’étais un peu perdu…
C’est à ce moment que Toshiki Okada est venu jouer Eraser Mountain à Gennevilliers, que j’avais déjà vu à Kanazawa. J’y ai revu Yuri Itabashi, dont j’avais adoré la physicalité et à qui j’ai pu parler du projet. Étant une actrice contemporaine détachée de la tradition, elle a accepté de s’interroger avec moi sur cette interdiction, de l’aborder et, pourquoi pas, de la contourner.
Okina a été créé à l’Atelier de Paris, centre de création chorégraphique. Le Mai japonais est vu comme un art dansé. Comment voyez-vous les frontières entre les disciplines ?
Dans mon travail, je ne fais pas une grande distinction entre théâtre et danse ou entre acteur et performer. Je m’intéresse à l’incorporation, à la plasticité des interprètes, plus qu’à la question du répertoire et de la littérature. D’où mon intérêt grandissant pour Okina, au fur et à mesure que je découvrais cette pièce rituelle.
Ce qui est fantastique avec Okina, c’est que par la reprise de danses très anciennes, on aboutit à une naissance possible du théâtre au Japon. C’est par le syncrétisme de divers rituels bouddhiques et shintoïstes d’avec des figures populaires et sacrées (et dont le masque de vieillard utilisé pour certaines danses permet en quelque sorte la théophanie) que s’invente une représentation détachée d’un cadre narratif strict mais davantage axée sur la valeur symbolique des danses et des chants qu’elle entend montrer. La danse permet dans ce cas précis de montrer quelque chose qui n’est normalement pas visible.
Que représente l’autel situé sur la scène d’Okina ?
C’est d’abord un élément qui participe à suggérer la géographie de l’espace (sacré) dans lequel Okina est représenté normalement. Et c’est surtout une façon de rendre compte du fait que l’interdiction faite aux femmes de jouer cette pièce est liée à son caractère rituel.
Cet autel est construit par Yuri pendant 10 minutes, avec simplicité mais avec grand soin. Je vois le temps pris pour monter ce Kamidana comme différent du temps théâtral, même si ce rituel a lieu en présence du public. J’aime que cette temporalité aille à l’encontre d’une quelconque efficacité théâtrale. C’est pour moi un luxe de pouvoir profiter de ce type de durée au théâtre.
L’autel impose à l’espace du plateau une croyance presque animiste et lui confère une valeur symbolique : la scène n’est plus une boîte noire mais cet endroit placé sous le regard du Kamidana. La façon dont Yuri – qui n’est pas particulièrement croyante – monte l’autel et effectue son rituel, vient aussi remettre en question les visions très emphatiques des rituels qu’on peut avoir en occident (et dans ses représentations théâtrales). Le rituel est ici une action simple ancrée dans le quotidien.
A la fin d’un Nô, l’acteur ne revient pas saluer. Dans Okina, Yuri revient.
C’est-à-dire qu’à la fin de la représentation, et bien qu’elle se soit approchée par ses danses de l’incorporation de ces figures divines que sont Okina et le personnage de Sambaso, Yuri est redevenue elle-même…
Comment avez-vous créé le texte en japonais avec Yuri ?
J’ai d’abord identifié une structure thématique où elle puisse raconter notre rencontre, et via notre rencontre sa découverte d’Okina alors qu’elle ne connaissait pas vraiment le Nô. Je lui ai partagé beaucoup de documentation et nous avons mené plusieurs entretiens avec Taro Yokoyama, un professeur d’histoire du Nô, accompagnés par le traducteur Akihito Hirano. Nous avons essayé de comprendre ensemble pourquoi il y a – toujours encore – cette interdiction de jouer Okina. Nous avons rattaché cette interdiction au concept de kegare (impureté et souillure liées au contact avec notamment la mort, l’accouchement, la maladie, la pourriture) fréquemment imputé aux femmes (les menstruations relevant elles-aussi du kegare). Au-delà des aspects didactiques, Yuri essayait de voir comment ces éléments pouvaient faire écho à son univers intime et à sa situation d’actrice contemporaine. Notamment, l’interdiction faite aux femmes de jouer Okina faisait écho à d’autres limitations qu’elle a vécu en tant que jeune femme japonaise.
Et le récit qu’elle en fait dans le spectacle est finalement une enquête pour comprendre en quoi et jusqu’où cette prescription du théâtre traditionnel la regarde.
Habituellement, je laisse une certaine liberté aux acteurs de modifier le texte lorsqu’ils jouent, mais comme Okina est sous-titré, la marge de manœuvre est plus limitée. Quant au surtitrage, une des tâches a été d’arriver à rendre compte des subtilités du texte en Japonais, qui parle beaucoup entre les mots et qui n’a pas toujours besoin de finir ses phrases pour qu’on le comprenne, notamment quand on parle d’interdit et de transgression. Ça n’a pas été facile !
Avez-vous d’autres projets liés à la culture japonaise ?
Je n’ai pas particulièrement le désir de devenir un spécialiste du théâtre japonais. Je pense donc que ma prochaine pièce n’aura aucun lien avec le Japon !
Cependant je sors du travail sur Okina avec pas mal de questions non résolues, notamment sur le lien entre la pensée shintoïste et l’écologie. Je reste travaillé par la dualité que j’y ai trouvée entre la pensée animiste et le productivisme du capitalisme tardif, avec sa surproduction d’objets inutiles. Le travail au théâtre de Toshiki Okada (avec des projets comme Eraser Mountain et Eraser Forest) et la pensée de Kohei Saito (auteur de Moins ! La décroissance est une philosophie) ont commencé à m’apporter de premières réponses…
Au Japon, j’ai aussi rencontré des masques de Kagura faits entièrement de matériaux naturels issus de la terre où ont lieu ces spectacles : la glaise, le gypse, les coquillages, les plantes lacustres, etc. J’espère arriver un jour à raconter leur histoire, l’histoire de ce chemin de la terre vers la scène.