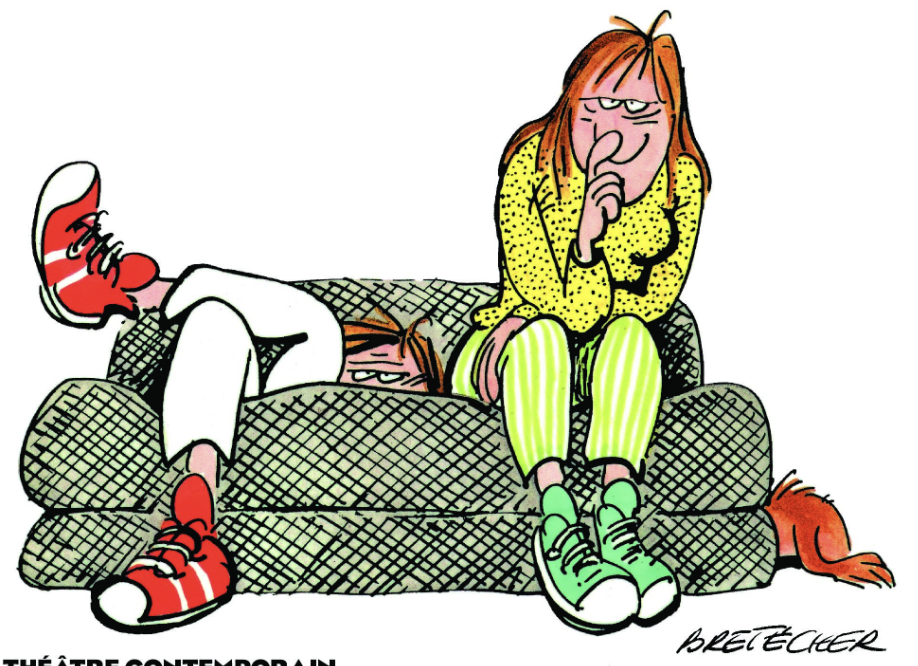Crédit photo : Jean-Guy Python
Lors d’une rencontre organisée par le Cours Florent, nous avons pu recueillir certains échanges entre des élèves et la grande comédienne Valérie Dréville, qui a notamment écrit L’esprit du débutant, paru en janvier 2024 chez Actes-Sud.
Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Pour le partage de l’expérience, pour la transmission. Cela fait plus de 20 ans que j’enseigne et j’avais envie d’ouvrir cette chambre secrète au-delà de mes seuls élèves. L’école du théâtre d’art dramatique de Moscou de Vassiliev était un laboratoire, avec rarement des représentations publiques. Ce que j’y ai observé et vécu, j’avais envie de le partager, d’en donner les clés. Je ne voulais pas garder ça pour moi. L’héritage ne se possède pas, il faut le partager. Le livre permet de faire tenir cette expérience dans les mains.
Contrairement à Face à Médée, qui était presque une copie de mon vrai journal de répétition pendant une période bien précise, L’esprit du débutant était plutôt inscrit dans ma mémoire émotionnelle. J’ai commencé à l’écrire pendant le confinement de 2020 et continué jusqu’en 2023. C’était un gros travail de réunir tous ces éléments, et de voir ce qui restait quand on a presque tout oublié.
Votre père était cinéaste. Vous vous êtes destinée au théâtre. Qu’est-ce qui a manqué au cinéma pour qu’on vous y voit davantage ?
Mon père a fait partie d’une génération qui dans les années soixante a été remise en cause par la nouvelle vague. Ça m’a marquée, enfant, de voir mon père ainsi mis de côté. Lui ,continuait à aimer passionnément le cinéma, même quand le cinéma ne l’aimait plus. Ça m’a à la fois blessée et appris quelque-chose. Quand j’étais plus jeune, je ne me sentais pas légitime au cinéma, peut-être à cause de ça. Mais depuis une dizaine d’années, le cinéma revient.
Vous êtes dans un apprentissage permanent. Qu’apprenez-vous en ce moment ?
Je travaille avec la chorégraphe Nacera Belaza, pourtant je ne suis pas danseuse. Ce que j’aime, c’est être déplacée. J’adore ça, et c’est pour cela que je suis partie à Moscou (après 5 ans à la Comédie Française – note du rédacteur). Ça me passionne d’être dans une situation où je ne sais pas ce qui va m’arriver. Je ne supporte pas l’idée de la routine.
Le meilleur moyen d’être toujours à l’écoute, c’est cette posture intérieure du débutant. Les années que je décris dans le livre m’ont laissé des traces si profondes que je ne pouvais plus revenir en arrière. il faut toujours que je remette en question mes savoirs, mes outils. C’est la seule façon de ne pas se rouiller.
Dans certains passages du livre, Vassiliev vous demande de puiser dans votre propre expérience, votre vécu. Pensez-vous que toute expérience de la vie peut être mise au plateau ?
Il faut remettre ce travail d’étude dans le contexte de l’école russe, de Stanislavski. Dans l’école russe, l’étude, c’est “lire avec les pieds”, avec le corps. Lors du travail à la table, on traverse l’action de chaque scène, ainsi que l’action transversale de la pièce, qu’on joue sans apprendre par coeur, pour voir si notre analyse de l’action était bonne. Puis on recommence et petit à petit on apprend l’ensemble de la pièce.
Pour comprendre l’action, il faut comprendre la situation, à partir des circonstances données. Et pour entrer dans les circonstances du rôle, Vassiliev nous demande de faire appel à des événements de notre vie qui entrent en résonance avec les circonstances du personnage. Il nous demande de faire une sorte de monologue intérieur qui crée un état mixte entre nos propres analogies, celles qui nous touchent émotionnellement, mélangées avec les circonstances du rôle. Cette stimulation du système nerveux nous permet, par intuition,de traverser la scène.
Faire appel à ses souvenirs, à son expérience, peut être intimidant, voire repoussant. Pourtant, il ne s’agit pas de “parler de soi”, mais de “faire avec soi-même”. On ne peut pas nier que notre instrument, c’est nous-même. Il faut donc plonger en soi. On a souvent beaucoup plus de vécu qu’on ne croit.
Comment faites-vous pour apprendre un texte ?
D’abord j’essaie d’en comprendre la structure. Dans Un Sentiment de Vie, il y a trois parties bien distinctes, avec chacune une écriture particulière. Je regarde aussi beaucoup la fin, c’est une lumière qui permet d’avancer, qu’il faut questionner. Il m’est arrivé d’apprendre certains textes lors des répétitions, mais pas celui-là, dont les phrases longues et complexes ont nécessité un travail préparatoire de quatre mois. Dans la première partie j’ai essayé de respecter l’unité de chaque phrase, de ne pas respirer à l’intérieur de chaque unité, même si c’était quasiment impossible. Vitez nous disait qu’il fallait respecter cette unité de la phrase, comme quand on marche dans les pas de quelqu’un sur une plage de sable, pour épouser son rythme, sa respiration. J’essaie aussi de repérer l’humour, particulièrement pour les textes denses ou douloureux, pour voir comment trouver de la légèreté. On ne descend jamais aussi bien dans les profondeurs que quand on continue à voir la lumière.
Ensuite avec le travail des répétitions, c’est le corps qui mémorise. Il faut lui faire confiance. On a trop souvent tendance à s’appuyer sur ses souvenirs, son intellect, ses sentiments. Le corps, lui, a une mémoire plus ancienne. Pour Médée-Matériau, à chaque reprise après une pause, je recommençais d’abord par travailler la partition physique. La mémoire intellectuelle d’un spectacle est focalisée sur le résultat. Mais le corps, lui, se souvient du processus.
Vous parlez beaucoup de la préparation physique dans vos livres. Quel type d’entraînement suivez-vous au quotidien ?
Je continue à m’entraîner régulièrement, en m’inspirant du travail fait avec Ilya Kozin, avec des activités comme le Tai-Chi, le Tao, les arts martiaux, le yoga et la méditation. Ce travail permet de travailler calmement, avec légèreté, et de créer la distance nécessaire entre le corps et les émotions. Ce travail aide à trouver son centre.
Avez-vous déjà eu envie d’arrêter ?
Non, mais on sait que dans la vie d’un artiste, il y a des cycles. Il peut y avoir des moments de latence. Pour les surmonter je ne crois pas à l’inspiration soudaine, je crois au travail.
Qu’est-ce qu’un Maître pour vous ?
Prenons une danseuse qui travaille à la barre. Le Maître va avec son bâton lui indiquer comment corriger sa position. Sans le Maître, la danseuse ne peut que se regarder dans le miroir, elle ne voit que son reflet extérieur. Avec le bâton, le maître modifie l’intérieur : la position des muscles, de ses os. Le Maître rend compte de ce processus intérieur, grâce à son expérience à lui, et ne juge pas seulement du résultat.
Le mot “Maître” fait peur, mais le Maître n’est pas omniscient, il ne fait pas à notre place. Simplement, il sait regarder.
Comment expliquez-vous votre attirance pour la Russie ?
Mon père a fini sa carrière en travaillant en Russie dans les années soixante. Là bas, il n’y avait pas de “Nouvelle vague” pour le remettre en question. Petite, j’étais fascinée par ce que mon père me montrait du pays, par la langue. Il y a donc eu une forme de retour quand j’y suis allée. J’ai d’ailleurs l’impression que le théâtre nous ramène toujours à l’enfance. Quand je cherche en moi pour mon travail de comédienne, j’y retourne toujours car les événements de l’enfance, même anodins, y sont vécus avec une acuité très forte. Le théâtre a besoin de ce niveau d’attention, de cet émerveillement qu’on perd en grandissant.
Comment les perturbations géopolitiques, l’actualité, impactent-elles votre art ?
L’influence est partout, même si je ne fais pas un théâtre de tribune. Le théâtre est un laboratoire des mouvements humains, à tous les niveaux : social, politique, métaphysique, et historique. Comme par exemple dans le travail que j’ai fait chez Sylvain Creuzevault sur Edelweiss [France Fascisme], où nous avons été accompagnés par un historien qui nous a énormément appris sur la période 1939-1945.
La situation actuelle pour les artistes en Russie est très dure. Ils sont obligés de se taire, et sont pour cela montrés du doigt par certains occidentaux, alors qu’ils vivent des tragédies personnelles, avec parfois des enfants en âge d’être mobilisés…
Quelle est la clé du lâcher-prise sur scène selon vous ?
Difficile à dire, mais il m’arrive d’avoir de grands moments de clarté après une très mauvaise répétition ou une mauvaise représentation. Un monologue intérieur se met en place, un passage, une ouverture se crée, des blocages sautent, et soudain des choses deviennent plus faciles. Mais le processus reste mystérieux, et ne relève pas simplement de notre volonté. Stanislavski disait que l’art de l’acteur était un océan. Heureusement, le travail permet d’y mettre quelques phares pour s’y retrouver.
Vous êtes comédienne depuis votre plus jeune âge. Comment votre passion pour le théâtre a-t-elle évolué ?
La flamme n’est pas la même à dix-sept ans et soixante-deux ans. A dix-sept ans, on tombe éperdument amoureux, on admire, on veut être admiré. L’amour des premiers temps a laissé la place à une foi profonde en le théâtre, qui est plus diffuse, et a moins besoin d’objets précis.
Avez-vous des souvenirs de spectatrices, de spectateurs ? Quel est votre rapport au public ?
En tant que spectatrice, Vitez et Grüber par exemple m’ont énormément marquée.
Et en tant que comédienne, mon rapport au public a beaucoup évolué. Quand j’étais plus jeune, je n’aimais pas vraiment le passage de la répétition aux représentations. Lorsque Vassiliev a monté le Bal Masqué à la Comédie Française, le travail d’étude dans une intimité totale, était un moment de vie extrêmement fort. Mais lors des premières représentations, une partie du public était scandalisée, avec beaucoup de chahut dans la salle. J’ai fait part à Vassiliev de mes difficultés à maintenir devant le public le travail réalisé en étude. Il m’a dit de ne pas penser à jouer pour le public, mais de penser que j’exerçais mon art en présence du public. Depuis, c’est une tâche que je me suis fixée.
Quand nous avons repris Médée-Matériau, beaucoup de spectateurs quittaient la salle. Comme je doutais de mon travail, Vassiliev a comparé ce que je faisais au rôle d’un prêtre lors d’une messe, soit quelqu’un qui n’est jamais perturbé par les allées et venues. Ça a complètement changé mon rapport au public. J’ai pris davantage conscience du rôle de chacun, spectateurs et acteurs, autour du rituel commun qu’est le théâtre. Je sais à présent que les spectateurs ne me regardent pas, mais qu’ils regardent quelque-chose à travers moi.
Quand des spectateurs partent parce qu’ils ne sont pas prêts à voir ce qu’on leur propose, je peux le comprendre en prenant du recul, même si ça me dérange sur scène, et que je n’adhère pas. Cette prise de distance me protège aussi.
Maintenant, je m’intéresse beaucoup plus au public. J’ai rencontré une fois un spectateur qui avait vu toutes les pièces de Claude Régy. Cet homme connaissait l’œuvre de Régy mieux que moi, qui avait pourtant joué dans sept de ses spectacles ! Ses souvenirs m’ont énormément touchée. Je pense aussi à cette spectatrice de 90 ans, fan absolue de théâtre, dont le mari est même mort au théâtre pendant une représentation. Elle y va quatre fois par semaine, et prend même le métro jusqu’à Bobigny ! Ces spectateurs-là sont précieux, ce sont de vrais “gens de théâtre”.
L’éducation du public reste essentielle. Un public averti qui a été bien habitué par les programmateurs est tout à fait capable de voir des spectacles exigeants, comme j’en ai fait l’expérience à Saint-Etienne, dans le Nord, et ailleurs.
Quelles qualités faut-il pour être comédien ?
De la patience, du courage, et beaucoup de désir. Je crois aussi que l’acteur a besoin de beaucoup de temps pour rêver. Au Conservatoire, Claude Régy nous demandait, plutôt que d’étaler nos compétences de jeu, de rêver en disant notre texte. Pour les jeunes comédiens qui cherchaient à prouver leur légitimité, c’était une libération.