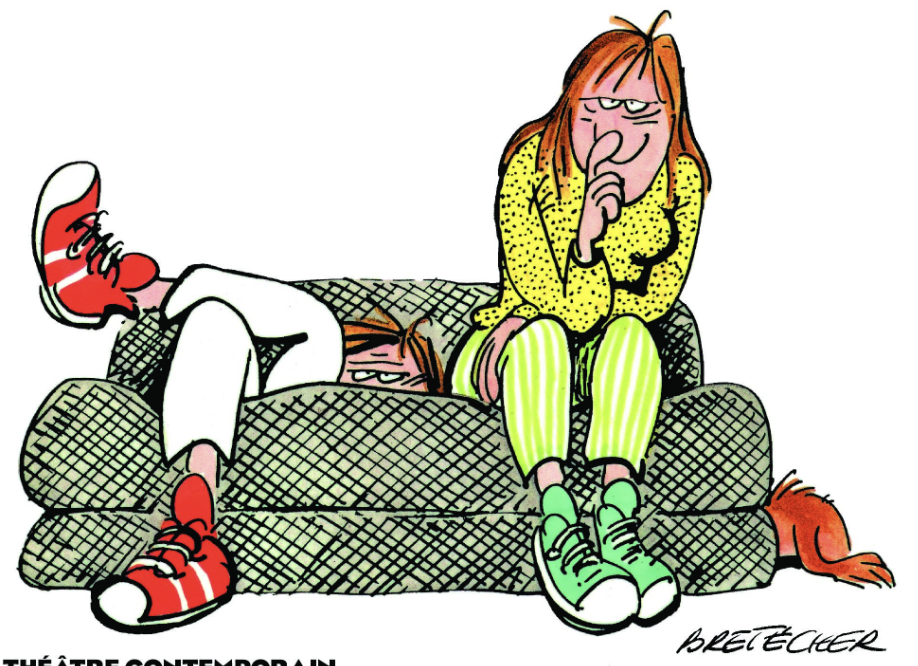Paris, place de la Nation, plein soleil d’hiver, tôt ce matin-là, les passants semblent tous sourire. La lumière blanche du soleil ne dessine qu’une ombre pâle sur le trottoir, et fait cligner les yeux de tous, illuminant les regards, lèvres et nez dissimulés, encore enfouis dans les écharpes.
Avec Benoit Giros, nous choisissons de nous installer à une terrasse orientée plein est, inondée par ce soleil froid et lumineux. Très peu de clients sont attablés, et le serveur nous apporte rapidement deux cafés. Immédiatement nos mains saisissent les petites tasses brûlantes, qui font alors office de petites chaufferettes.
Les yeux rieurs et le timbre posé, Benoit Giros parle calmement, il prend son temps, ses mots sont choisis et précis. Il semble soucieux de se faire comprendre, tout en prenant soin de ne pas envahir son interlocuteur. Homme de théâtre et de cinéma, Benoit Giros est acteur, comédien, auteur et metteur en scène. A ces différentes casquettes s’ajoutent également celle de professeur d’art dramatique.
Karine Delzac : Pour commencer, Benoit Giros, que pensez-vous de la situation du théâtre en France, et de celle des comédiens ?
Benoit Giros : Le théâtre a beaucoup changé depuis 5, 10 ans, un peu comme ce qui se passe pour le cinéma, depuis un peu plus longtemps. Il y a de très grosses productions et de tous petits spectacles. Une grande partie du paysage du théâtre est bouleversée par la diminution des moyens du théâtre subventionné, et aussi par l’arrivée du stand-up.
Depuis les années 2000, les dotations de l’état pour la culture baissent. Avant, nous étions beaucoup appelés à créer, maintenant nous sommes beaucoup plus appelés à diffuser.
En même temps, pour les acteurs et les comédiens, il y a plus de débouchés, avec les séries, les programmes TV, et il y a aussi plus de salles. Les one-man-show et les stand-up se développent, et augmentent les possibilités de travail. Beaucoup d’écoles de théâtre et de cinéma se sont créées, et forment beaucoup d’acteurs et d’actrices, qui chaque année arrivent nombreux sur le marché du travail. C’est un noyau où la vie bouillonne et c’est très formateur, car c’est un univers assez concurrentiel. C’est notre endurance à supporter les échecs et les critiques, ainsi que notre capacité à nous remettre en question, qui font que nous continuons dans ce métier-là. Et Ariane Mnouchkine existe encore, donc c’est bien !
KD : Faites-vous une différence entre une carrière de comédien de théâtre et celle d’un acteur de cinéma ?
BG : À la base c’est vraiment le même métier. Techniquement, la préparation des rôles s’aborde de la même manière, on va chercher en soi les intentions du personnage, on recherche ce qu’on a envie de raconter là-dedans. On cherche à quel endroit le rôle nous parle. Surtout qu’aujourd’hui, l’acoustique des salles est tellement bonne, qu’il n’y a plus besoin de crier au théâtre, sauf exceptionnellement une fois dans la vie, si on joue à Avignon, dans la cour d’honneur du Palais des Papes, où là on va devoir pousser un peu la voix. Aujourd’hui tous les acteurs et les actrices apprennent à jouer à voix normale.
La différence principale entre le théâtre et le cinéma, tient dans le rythme de travail. Le théâtre c’est un sacerdoce. Pour un spectacle qui marche, c’est tous les soirs au théâtre de 18h à 23h. On se donne au public, et on lui raconte tous les soirs la même histoire, il y a quelque chose du domaine de la cérémonie.
Le cinéma c’est une plongée, dans un rôle, dans une atmosphère lors du tournage, et ensuite on va chercher les lauriers, on accompagne le film pendant un an.
Il y a un truc dans le rythme qui n’est pas le même. Au bout d’un moment, quand on fait du cinéma, ou de la télé, il y a une manière d’appréhender le métier qui n’est plus tout à fait la même qu’au théâtre. Je pense qu’il vaut mieux commencer sa carrière au théâtre, parce que les grands rôles sont au théâtre, et ce sont les grands rôles qui apportent de la profondeur au jeu d’un acteur, et qui développent l’amour des textes, après si on fait du cinéma, tant mieux!
KD : Dans la pièce de Denis Lachaux La magie lente, à propos de la violence qui devait être représentée sur scène, vous avez dit qu’il s’agissait de trouver une chose fausse, pour qu’elle paraisse vraie sur scène. Qu’entendez-vous par là ?
BG : C’est une idée que je pense être fondamentale pour le théâtre. En fait, au théâtre, on est chargé de recréer la vie dans un endroit qui n’existe pas. C’est à dire, qu’un plateau de théâtre, ce n’est que minéral, ce n’est que technique. Ainsi, pour que la vie semble vraie dans ce contexte, il faut que tout soit faux. C’est un peu remis en cause aujourd’hui, mais l’idée est que si on introduit un chien, ou une plante verte sur la scène, alors on vient briser une harmonie du minéral par l’introduction de l’organique.
C’est pareil pour l’actrice ou l’acteur, il faut que l’actrice, ou l’acteur soit quelque chose d’entièrement créée de A à Z, que ce soit le plus artificiel possible et le plus cohérent possible pour que cela paraisse vrai. C’est l’harmonie du faux qui devient garante de la cohésion du ressenti, ce qui se déroule sur la scène apparait vrai alors que néanmoins tout est faux.
Pour La Magie lente, dramaturgiquement parlant, le texte est écrit pour que les spectateurs soient prisonniers du processus de l’écriture. Tout semble prévu, même ce qu’allaient ressentir les spectateurs, ainsi que la manière dont ils allaient être engloutis par l’histoire. Tout est faux, mais à l’intérieur de ce cadre, à l’intérieur de cette chose entièrement fabriquée, moi, acteur, je pouvais être au plus proche de ce qu’aurait été la vie, ou la vérité.
Par exemple, le spectacle du Munstrum, 40 degrés sous zéro, ceux sont des comédiens qui font beaucoup de masque et leur spectacle c’est du Copi. Et Copi, c’est une écriture punk qui parle de gens qui se droguent, qui meurent, qui ressuscitent, qui se tirent dessus, qui meurent, qui ressuscitent à nouveau. La pièce est jouée avec des masques. Dans le masque tout est codé, c’est l’archétype même de l’artificiel. La rencontre entre le Munstrum et Copi, donne un spectacle, où tout est millimétré, n’importe quel regard est joué à la seconde prêt, et le spectateur a l’impression de voir la vie se créer et se recréer devant ses yeux.
Plus on va vers cette frénésie de fabrication, plus on va vers l’impression que ce qui se joue devant soi est vrai. Alors qu’avec des spectacles, où les choses sont plus laissées au hasard, ces spectacles vont marcher une fois, et vont se tarir d’une représentation à l’autre. C’est vraiment dans cette précision que la vie peut éclore.
KD : Dans la pièce La magie lente, vous disiez que c’était comme si le rôle avait été créé pour vous. Pensez-vous qu’une identification aussi forte soit un élément facilitateur pour interpréter votre personnage ?
BG : Ah, oui ! Oui !
C’est aussi une question de rencontre avec des rôles. Quand une pièce est bien écrite, les lignes souterraines du rôle viennent, tout à coup, rejoindre les lignes souterraines que l’acteur a traversées. Et alors c’est, comme si on avait une connaissance profonde du rôle. Le rôle fait resurgir des choses connues et inconnues, indépendamment de toute volonté.
Les grands interprètes ont une connaissance d’eux mêmes qui leur permet d’interpréter pleins de rôles et d’avoir ce surgissement profond de leurs lignes souterraines. Un peu plus généralement, pour les acteurs et les actrices, il y a des rôles qui s’imposent à eux, parce que c’est une rencontre. Alors on apprend de ces rôles-là.
Quand ce sont de grandes autrices, ou de grands auteurs, c’est plus simple pour l’acteur, parce que les grandes lignes sont clairement dessinées. Il y a quelque chose qui a à voir avec cette construction imparable de comment la vie est redessinée. C’est à ça qu’on reconnait les grands auteurs ou autrices, et dans ce cas, ça aide l’actrice ou l’acteur à devenir une grande actrice ou un grand acteur.
KD : Vous avez écrit une magnifique radiophonie Le Grand Nord, pouvez-vous nous retracer l’histoire ce cette création ?
BG : Et bien, là aussi c’est une rencontre… j’étais chez un ami, et j’ai vu La trilogie de la solitude de Glenn Gould, je regarde le disque et je suis frappé par l’inscription : « Le Grand Nord est un endroit, où on devient philosophe ». Alors je me suis acheté ce disque, je l’ai écouté, j’ai commencé à fouiller ses textes en anglais et à me demander qui était Glenn Gould. Et là un continent s’est ouvert. Le continent Glenn Gould, le continent de la musique classique, le continent du Grand Nord, des Inuites…
Ma mère est pianiste, et c’était au moment de sa vie, où elle commençait à être malade. C’est comme si, ça m’avait rapproché de quelque chose d’elle, que je ne connaissais pas, et où je n’avais plus accès. Ça m’a pris à peu près 5 ans à découvrir ce continent. Et ces années m’ont fait grandir, et m’ont permis de me mettre à la mise en scène.
Ensuite j’ai rencontré Marguerite Gateau, qui est la réalisatrice de cette émission. Elle a plongé dans ce projet avec moi, elle a retranscrit l’itinéraire, et elle a eu envie de faire partager ma découverte, car Glenn Gould était surtout connu pour ses enregistrement au piano, comme interprète. Voilà c’est plein de rencontres qui ont émaillé l’exploration de ce continent.
Dans ce continent, il y avait aussi la découverte d’un continent intérieur en moi, qui était celui de la création, que je n’avais jamais osé aborder jusque là, de manière aussi individuelle. Cette oeuvre était si puissante, qu’elle m’a transporté.
Le Grand Nord, Glenn Gould l’avait fantasmé pendant des années, et pour lui, ça représentait aussi une métaphore de l’art. Lui, qui était interprète, grâce au Grand Nord, il s’est transformé en artiste, en créateur. Et sans m’en rendre compte, ça m’a permis de penser à faire de la mise en scène. La radiophonie est devenue ensuite un spectacle, que j’ai mis en scène. Et « L’idée du Nord » est devenu le nom de ma compagnie, qui existe depuis la création de ce spectacle, en 2010. Cette histoire est à l’origine de toutes mes mises en scène.
KD : Avec la pièce de Pierre Notte, Une merveilleuse histoire de sexe dégueulasse, que vous avez mis en scène et dans laquelle vous jouez tous les deux, vous emmenez les spectateurs à la lisière de ces zones limites, touchant à la solitude et au sexe, pouvez vous retracer votre processus de création et d’écriture de cette mise en scène ?
BG : La pièce a été écrite pour moi. Elle nécessite un dévoilement. Alors j’ai pensé à une mise en scène complètement fausse, un environnement, comme s’il s’agissait de deux clowns de cirque. Et le numéro de ces deux clowns devrait être comment ils sont amenés et obligés de se mettre à nu pour pouvoir vivre quelque chose de vrai. Au cours de la pièce, on assiste ainsi, progressivement à ce dévoilement. On avance vers des zones complexes et profondes, mais le texte nous guide tout du long de la pièce. Alors, la mise en scène, c’est d’essayer d’éclairer la profondeur du texte, qui nous fait nous dévoiler nous-mêmes parce qu’on est pris dans les filets du texte.
Pour moi, parler de solitude, de sexe, ou d’enfances brisées, ce sont des thèmes qui portent vers des endroits de transgression, où tu découvres des trucs qui te percutent et qui te font peur. Tu vas alors essayer de parler d’endroits limites de ce qu’est l’être humain. Je trouve que le théâtre est intéressant quand il va fouiller à cet endroit là, quand il arrive à aller chercher cette limite là. Ça peut être dans le divertissement, comme dans la folie de Feydeau, et dans plein d’autres choses aussi… mais il faut emmener les spectateurs avec soi, il ne faut pas les bloquer. Je trouve de l’intérêt à explorer, et à aller rechercher ça.
KD : Dans votre rôle de professeur, vous êtes aux prises avec la transmission aux futurs acteurs, et c’est aussi un retour sur votre propre formation, comment vivez-vous cette position et que vous apporte-t-elle ?
BG : En fait, cela me permet de mettre des mots sur des idées, d’avoir une parole forte. Quand je n’étais pas professeur, je pouvais facilement me dire : « ça je le sais ! », mais lorsqu’il s’agit d’en parler à d’autres, d’être compris par tous, cela nécessite de trouver une forme qui soit compréhensible pour les autres, et en retour cela te permet de te construire, parce que tu dois mettre tes idées en ordre. Tu dois absolument clarifier ta pensée. Et c’est en travaillant tes cours que tu peux aider les autres à progresser.
J’ai commencé à enseigner au même moment que j’ai créé la compagnie. Et c’est devenu tout de suite évident pour moi.
En France, contrairement à ce qui se passe en musique, où les instrumentistes sont professeurs, en théâtre il n’y a pas cette tradition. C’est comme si tu ne pouvais pas être artiste en étant professeur. Et je pense que c’est une grosse erreur du système, qui tient entièrement à la tradition française du théâtre et du cinéma, et à la représentation du génie artistique. C’est l’idée qu’un artiste doit être un génie, et le génie ne s’enseigne pas ! Aujourd’hui ça commence à changer, et c’est bien d’assister à ça, car néanmoins il y a des oeuvres incroyables qui sont faites, en dehors du fait d’être géniales.
En savoir plus sur Benoît giros : Site officiel
Prochaines dates
- La disparition de Josef Mengele de Olivier Guez
Adaptation de Mikaël Chirinian
Mise en scène de Benoit Giros
Interprétation : Mikaël Chirinian
Festival Mises en Capsule
Théâtre du Chêne Noir à Avignon du 29 juin au 21 juillet 2024. - Mon père (pour en finir avec) de Pierre Notte
Mise en scène de Pierre Notte
Le 24 Mai 2023 au Théâtre Victor Hugo de Bagneux